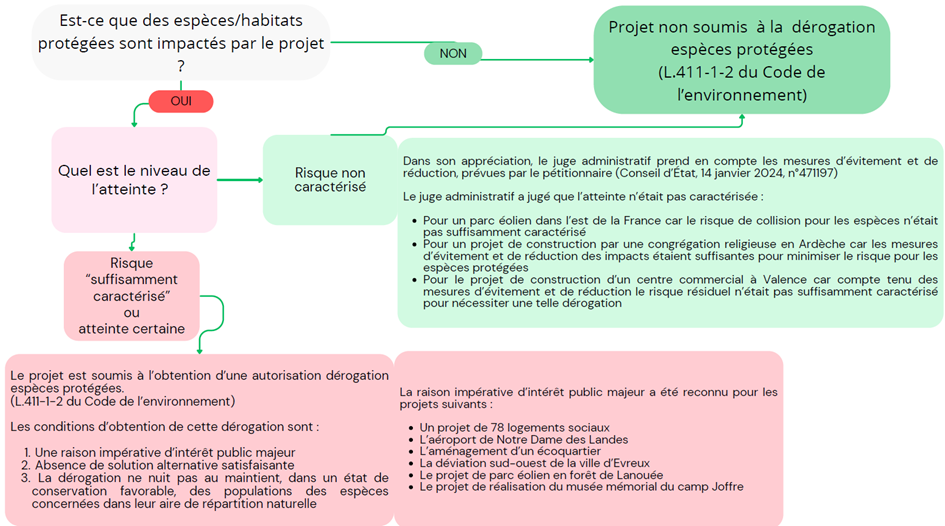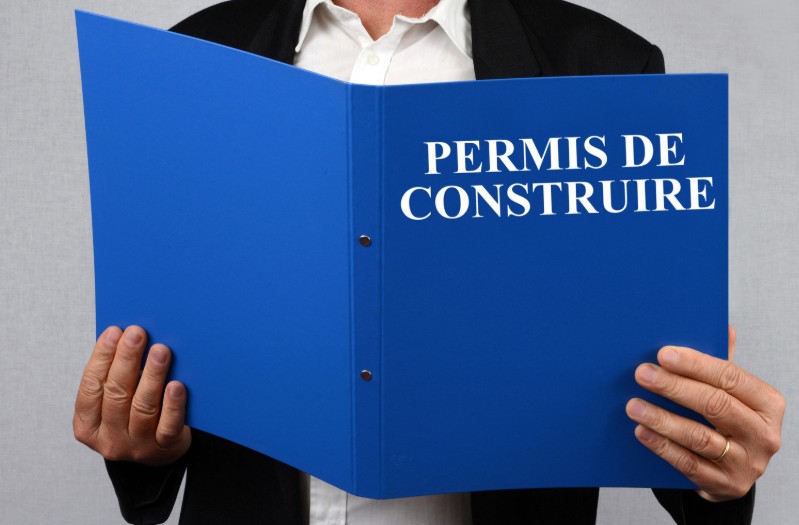Par un avis attendu du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat précise que l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de mise en demeure de remettre en état ou de régulariser des travaux irréguliers ou illégaux conférés par l’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est encadré par un délai de prescription de six ans à compter du jour de la commission de l’infraction, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, le maire de Sérignan (Hérault) avait, par un arrêté interruptif de travaux, mis en demeure des particuliers, sous un mois, d’enlever une clôture en bois et de démolir une construction implantée sur un terrain leur appartenant, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un jugement n° 2304765 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande d’annulation dudit arrêté, a transmis au Conseil d’Etat les questions suivantes :
1/ Une prescription, qui s’inspirerait de la prescription civile prévue par l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, pourrait-elle s’attacher au pouvoir conféré à l’autorité administrative par l’article L. 481-1 du même code, en vertu d’un principe général du droit, et si oui, dans quelles conditions (durée et point de départ) ?
2/ Le cas échéant, comment s’articulerait cette prescription avec la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ?
Pour rappel, les articles L. 481-1 et suivant du code de l’urbanisme permettent à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, lorsqu’un procès-verbal a constaté que des travaux ont été entrepris irrégulièrement, d’exercer ses pouvoirs de police spéciale, indépendamment de toute poursuite pénale.
Après avoir recueilli les observations de l’intéressé, elle peut ainsi le mettre en demeure, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire en vue de la régularisation des travaux, soit de les mettre en conformité avec la réglementation applicable, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires (CE, 22 décembre 2022, n° 463331).
Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard (et d’au maximum 25.000 €) prononcée dès l’origine ou ultérieurement, à condition que l’intéressé ait été de nouveau invité à présenter ses observations.
En réponse aux questions posées par le TA de Montpellier, le Conseil d’État considère que, dès lors que l’exercice des pouvoirs prévus aux articles L. 481-1 et suivants est conditionné par un constat préalable d’infraction établi par procès-verbal en application de l’article L. 480-1, le législateur a exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique. Dès lors, s’agissant de faits susceptibles de revêtir la qualification de délits, et sous réserve de l’intervention d’actes interruptifs de la prescription, le délai de prescription est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale.
La Haute juridiction précise également que lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés de manière successive, seuls ceux non prescrits peuvent faire l’objet d’une mise en demeure. Pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable visant à leur régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité compétente doit notamment tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, qui prévoient que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sous réserve, notamment, que cette construction n’ait pas été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis. Si les travaux ne peuvent être ainsi régularisés, les opérations nécessaires à la mise en conformité, y compris, le cas échéant, les démolitions qu’elle impose, ne peuvent porter que sur ces travaux.
Cet avis du Conseil d’Etat attendu vient mettre un terme à un débat juridique important et source d’une insécurité significative pour les maîtres d’ouvrage. Elle apporte une clarification salutaire, d’autant plus essentielle que la petite loi de simplification du droit de l’urbanisme, dans sa version adoptée par le Sénat le 3 juillet dernier, prévoit un renforcement des sanctions administratives, accentuant la nécessité d’une stabilité et d’une prévisibilité accrues dans ce domaine.
Ainsi, dans cette nouvelle version de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme – qui peut toujours évoluer avec le vote de l’Assemblée nationale -, la mise en demeure peut être, d’office, assortie d’une amende de 30.000 euros maximum. L’astreinte pas à 1.000 euros maximum par jour de retard pour un montant maximum de 100.000 euros (article 4 de la petite loi).
CE, avis, 24 juillet 2025, n° 503768, publié au recueil Lebon